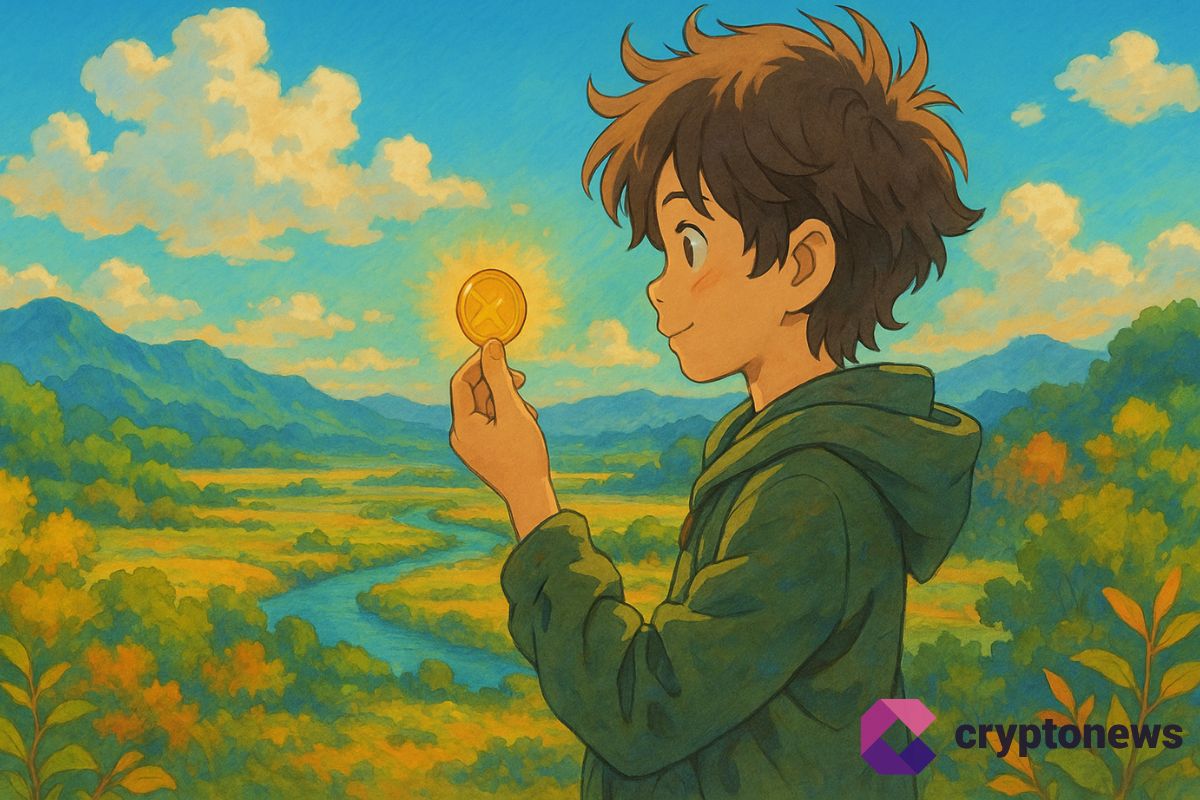Les tarifs douaniers viennent de faire s'effondrer les marchés : allons-nous vers une récession ?
En bref Le 10 octobre, l'annonce par le président Trump d'une imposition de droits de douane de 100 % sur la Chine a déclenché un krach boursier historique, effaçant 1 500 milliards de dollars de valeur en actions et en cryptomonnaies, suscitant des craintes d'une potentielle récession aux États-Unis.
Le vendredi 10 octobre, le président Trump a déclaré de l'huile sur le feu dans sa longue guerre commerciale avec la Chine , et les marchés ont immédiatement paniqué. Il a annoncé des droits de douane de 100 % sur la Chine, ainsi que de nouvelles interdictions d'exportation. En quelques heures, tous les marchés se sont effondrés et les investisseurs se sont tournés vers l'or et l'argent.
On sentait la peur se propager à chaque instant. Les traders se sont mis à vendre, les liquidations ont accéléré le mouvement et, en quelques heures seulement, environ 1 500 milliards de dollars de valeur boursière ont disparu. Puis, nous avons assisté à un léger rebond. Mais la question demeure : sommes-nous au début d’une véritable récession ?
Que s'est-il passé exactement
Tout a commencé par une simple publication sur Truth Social vendredi matin. Trump accusait la Chine d'adopter une « position commerciale extrêmement agressive » et annonçait qu'il réagirait en imposant des droits de douane de 100 % sur toutes les exportations chinoises vers les États-Unis à compter du 1er novembre. Il menaçait également de bloquer les exportations de « logiciels critiques » américains vers la Chine.
Par l' fin de la journée :
- Le S&P 500 a chuté de près de 3 % ;
- Le Nasdaq a chuté de 3.5 % ;
- Le Dow Jones a perdu près de 900 points ;
- Le Bitcoin est passé d’environ 122 000 $ à 104 000 $ en quelques heures ;
- Plus de 19 milliards de dollars de positions cryptographiques ont été anéanties, soit la plus grande liquidation en une seule journée de l'histoire.
L'or et l'argent, valeurs refuges classiques, ont tous deux atteint des sommets. Le message des investisseurs était simple : oubliez le risque et privilégiez la sécurité.
Pourquoi tout le monde a paniqué si vite
L'économie américaine montre déjà des signaux contradictoires. La croissance ralentit, l'inflation repart à la hausse et les embauches ralentissent. Les droits de douane aggravent ces trois problèmes. Ils augmentent les prix, perturbent les chaînes d'approvisionnement et incitent les entreprises à suspendre leurs investissements.
Les marchés boursiers et cryptographiques regorgent d'argent emprunté via des transactions à effet de levier. Lorsque les investisseurs empruntent pour acheter davantage d'actifs, les gains semblent prometteurs, jusqu'à ce que les prix commencent à chuter. Cet emprunt se transforme alors en piège. Dès que les prix dépassent un certain seuil, les courtiers et les plateformes d'échange vendent automatiquement leurs actifs pour couvrir les pertes. C'est ce qui s'est produit vendredi. C'est une réaction en chaîne de ventes forcées qui a aggravé le krach.
Et enfin, la peur : les marchés fonctionnent grâce à la confiance. Quand le président menace une guerre commerciale mondiale Et les investisseurs ne savent pas s'il est sincère, la confiance s'évanouit. Les traders n'attendent pas de savoir, ils vendent.
Au cœur de l'effondrement des cryptomonnaies
Les cryptomonnaies ont subi le choc encore plus durement que les actions. En quelques minutes, des centaines de milliers de traders ont vu leurs positions disparaître. Le Dogecoin a chuté de plus de 50 %. L'Ethereum a perdu plus de 20 %. Pour ajouter au chaos, l'un des stablecoins de Binance, indexé sur le dollar, a brièvement perdu sa valeur de 1 $, alors que les volumes d'échanges ont grimpé en flèche. Certaines plateformes ont même signalé des pannes temporaires ou des « problèmes techniques », ce qui n'a fait qu'attiser la panique sur les réseaux sociaux.
Durant le week-end, le bitcoin s'était légèrement redressé pour atteindre environ 115 000 dollars, mais le moral restait instable. Les traders ont qualifié cet événement de « mini-cygne noir », un choc soudain qui rappelle à tous la fragilité du système.
Le rebond du lundi et pourquoi il pourrait ne pas durer
Le lundi 13 octobre, la situation semblait plus calme. Trump a publié un nouveau message disant : « Ne vous inquiétez pas pour la Chine, tout ira bien ! » Les actions ont rebondi d'environ 1 %, le bitcoin a légèrement progressé et les gros titres ont commencé à parler du « TACO trade », abréviation de Trump Always Chickens Out.
C'est une vieille blague boursière : Trump tient un discours ferme, les marchés s'effondrent, puis il fait marche arrière juste assez pour faire croire aux investisseurs que tout rentrera dans l'ordre. Mais même si les indices se sont légèrement redressés, l'or a continué de grimper et les rendements obligataires de baisser, deux signes que l'argent continue de se réfugier dans la sécurité. Autrement dit : les traders ne font pas confiance à ce rebond.
Pourquoi cette guerre commerciale frappe plus durement que la précédente
En 2018-2019, la première guerre commerciale de Trump avec la Chine a provoqué une certaine volatilité, mais n'a jamais entraîné de krach boursier majeur. À l'époque, les deux parties avaient simplement signé une trêve temporaire et les marchés avaient poursuivi leur hausse. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ?
- Les tarifs sont beaucoup plus élevés.
Il ne s'agit pas de 10 % ou de 25 %. Il s'agit de 100 % sur tous les produits chinois, de l'électronique aux vêtements en passant par les pièces automobiles. - Le monde est plus fragile.
Les chaînes d’approvisionnement mondiales traversent déjà des moments difficiles en raison des conséquences de la pandémie et des guerres. - Les États-Unis sont plus endettés.
Les ménages, les entreprises et les fonds spéculatifs affichent un endettement record. Lorsque l'endettement est élevé, même les chocs mineurs sont plus graves. - La Fed a moins de marge de manœuvre.
Les taux d'intérêt sont déjà élevés, et pourtant l'inflation n'a pas encore atteint le niveau souhaité. La banque centrale ne peut pas simplement baisser ses taux sans risquer une nouvelle flambée d'inflation.
En termes simples, le système dispose d'une marge de manœuvre moindre qu'il y a cinq ans. Une nouvelle guerre commerciale prolongée pourrait facilement le faire basculer dans la récession.
Le dilemme de la Fed
La Réserve fédérale est désormais confrontée à un scénario classique sans issue. Elle doit s'efforcer de maintenir la stabilité des prix et un emploi solide, mais ces objectifs vont dans des directions opposées.
Si la Fed baisse ses taux pour soutenir l'emploi, l'inflation augmentera à nouveau, les tarifs douaniers faisant grimper les prix. Si elle maintient ses taux à un niveau élevé pour lutter contre l'inflation, le marché du travail pourrait s'affaiblir davantage et entraîner l'économie dans la récession.
Les économistes qualifient cette situation de trilemme : on ne peut pas avoir simultanément une faible inflation, un faible chômage et la stabilité financière. Il faut faire des concessions. Et pour l'instant, la Fed se trouve entre ces deux extrêmes, ne sachant pas quoi faire.
Allons-nous vers une récession ?
Certains experts pensent que nous sommes plus proches que la plupart des gens ne le pensent. JPMorgan le pense . A modèle d'apprentissage automatique de Moody's Analytics , qui a correctement prédit toutes les récessions américaines depuis 1960, affiche désormais une probabilité de 48 % d'en voir une au cours des 12 prochains mois. Tout taux supérieur à 50 % a toujours été suivi d'un ralentissement économique.
Plusieurs signes avant-coureurs clignotent :
- Les embauches ont ralenti;
- Les dépenses de consommation ont atteint un plateau ;
- Les bénéfices des entreprises diminuent à mesure que les coûts des intrants augmentent et que la demande ralentit ;
- L’inflation remonte lentement.
L'indice des prix PCE, mesure privilégiée par la Fed, a progressé de 2.7 % en août et devrait atteindre 2.9 % d'ici la fin de l'année. Les économistes qualifient ce phénomène de stagflation, de croissance ralentie et de hausse des prix. C'est le contexte le plus difficile pour les décideurs politiques et les investisseurs, car les outils traditionnels ne fonctionnent plus.
Baisser les taux risque d'aggraver l'inflation ; les relever risque de provoquer davantage de licenciements. C'est pourquoi de nombreux analystes avertissent désormais que les marchés sous-estiment le risque.
Le problème de la complaisance
Depuis des années, les investisseurs ont appris que toute baisse du marché est compensée, soit par un revirement de la Fed, soit par des reculs politiques. Cela engendre un sentiment de complaisance. Les rendements obligataires restent bas, les investisseurs empruntent à bas prix et tout le monde se rue sur les mêmes transactions. Ça marche, jusqu'à ce que ça ne marche plus. Et puis tout s'effondre rapidement.
Le danger n'est pas que les gens ignorent les risques. C'est qu'ils pensent pouvoir s'en sortir à temps. L'histoire montre qu'au moment où les sonnettes d'alarme retentissent, les sorties sont bondées et la liquidité disparaît. C'est ce dont nous avons eu un aperçu vendredi : le premier véritable test de résistance d'un marché bâti sur l'optimisme et l'argent emprunté.
Trois façons dont cela pourrait se dérouler
Décomposons les scénarios les plus probables pour les mois à venir.
1. Trump recule
Trump signe un accord partiel ou reporte les droits de douane. Les marchés affichent un certain soulagement, les actions rebondissent et les cryptomonnaies retrouvent leur équilibre. Ce phénomène s'est déjà produit à plusieurs reprises.
2. L'impasse s'éternise
Les discours s'apaisent un peu, mais les droits de douane restent en vigueur. Les entreprises freinent leurs dépenses, l'inflation reste élevée et les marchés restent volatils.
3. La bagarre s'intensifie
Les droits de douane persistent, la Chine riposte, les chaînes d'approvisionnement mondiales se paralysent et l'inflation grimpe en flèche. La Fed ne parvient pas à baisser ses taux, la croissance stagne et les actifs risqués continuent de s'effondrer.
Que disent les pros à ce sujet ?
Les analystes restent prudents. Ils estiment que le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine pourrait avoir des répercussions sur les marchés mondiaux. Mike Wilson, stratégiste en chef actions américaines chez Morgan Stanley, avertit que les investisseurs Ils sous-estiment les dommages potentiels d'une nouvelle levée des droits de douane. Il estime que le S&P 500 pourrait chuter de 10 à 15 % en cas d'échec des négociations, affirmant que les marchés sont « optimisés » depuis le printemps. Wilson recommande aux investisseurs de privilégier les secteurs défensifs comme la santé et les services publics, moins exposés aux chaînes d'approvisionnement chinoises, et de rester prudents dans les secteurs des semi-conducteurs et de la consommation discrétionnaire.
Larry Fink, PDG de BlackRock, est d'accord avec lui Il a décrit la nouvelle vague de droits de douane comme « au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer », affirmant qu'elle pourrait entraîner l'économie américaine vers la récession si elle était maintenue. Le BlackRock Investment Institute estime que le taux effectif des droits de douane pourrait bientôt atteindre 20 à 25 %, un niveau jamais vu depuis des décennies, combinant une croissance plus faible et une inflation plus élevée, « un mélange toxique pour les actifs à risque ».
Paul Krugman donne une critique plus structurelle Le lauréat du prix Nobel affirme que, malgré les discours politiques, les États-Unis pourraient en réalité être plus vulnérables que la Chine dans une guerre commerciale prolongée. Il affirme que les États-Unis restent dépendants des intrants chinois, des biens de consommation aux minéraux essentiels, tandis que Pékin peut compenser les pertes par des mesures de relance intérieures. Krugman suggère que les droits de douane risquent de nuire davantage aux marchés américains qu'à ceux de la Chine, à mesure que les perturbations des chaînes d'approvisionnement et les mesures de rétorsion s'accentuent.
Ces perspectives témoignent d'un rare consensus parmi les analystes, souvent en désaccord : l'escalade tarifaire n'est pas un bruit de fond. Elle témoigne d'un véritable choc macroéconomique, capable de faire dérailler à la fois les bénéfices des entreprises et le moral des investisseurs.
Pourquoi ce moment est important
Tous les deux ou trois ans, le marché est confronté à la réalité. Le krach de vendredi n'était pas seulement dû aux droits de douane ; il était aussi lié à la fragilité. Il a montré à quel point tout est devenu étroitement lié : actions, cryptomonnaies, matières premières, politique.
Un seul titre peut désormais se propager à travers les algorithmes, les robots de trading et les portefeuilles mondiaux en quelques secondes. Il a également démontré que la peur a toujours du pouvoir.
Depuis des mois, les investisseurs agissent comme si les mauvaises nouvelles n'avaient aucune importance. L'inflation, defiVilles, chaos politique, guerres. Vendredi a rappelé à tous que le risque ne disparaît jamais, il se cache simplement jusqu'à ce que la bonne étincelle éclate.
Que cela se transforme en un événement plus important ou en une simple correction rapide dépendra de deux facteurs : la prochaine décision de Trump et la réponse de la Fed. Si les deux trébuchent simultanément, l'onde de choc ne se limitera pas aux graphiques cryptographiques ; elle affectera l'emploi, les prêts hypothécaires et les épargnes retraite.
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
Vous pourriez également aimer
American Bitcoin booste ses réserves : +163 M $ en BTC pour le clan Trump
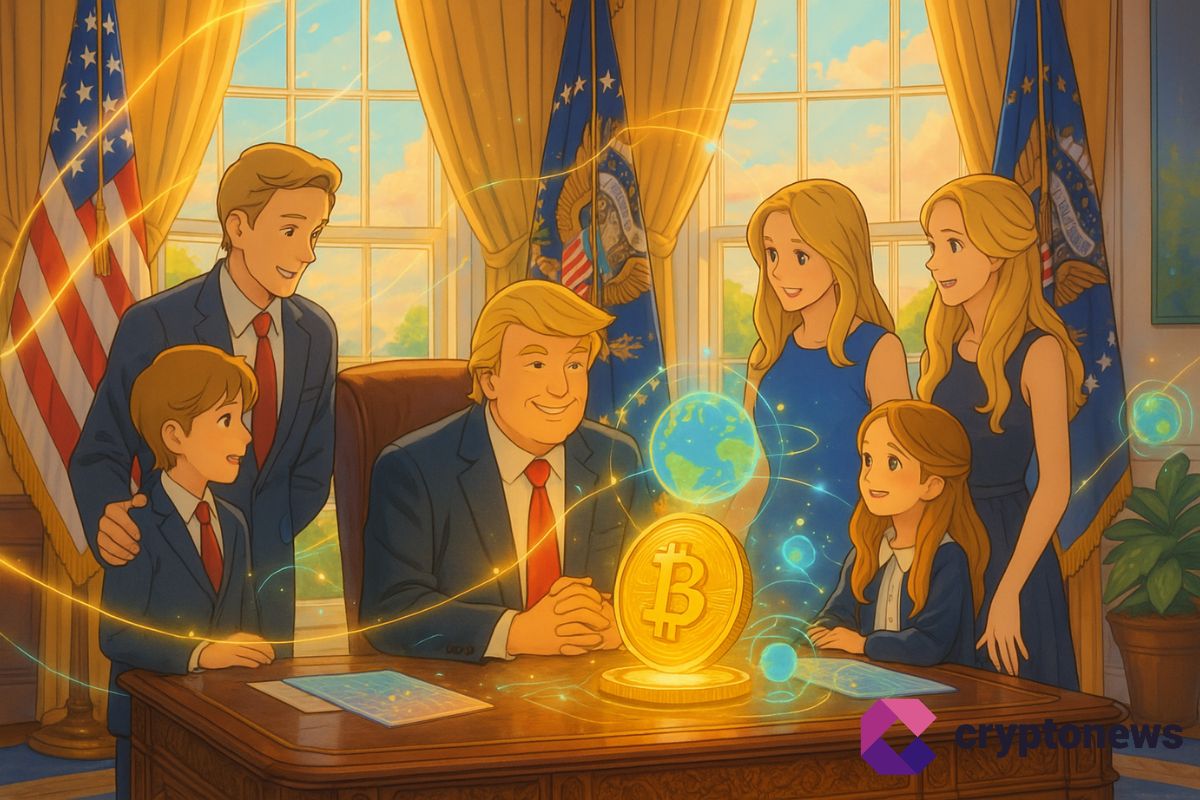
L’IA identifie le prochain XRP : cette crypto pourrait devenir la star du prochain bull run